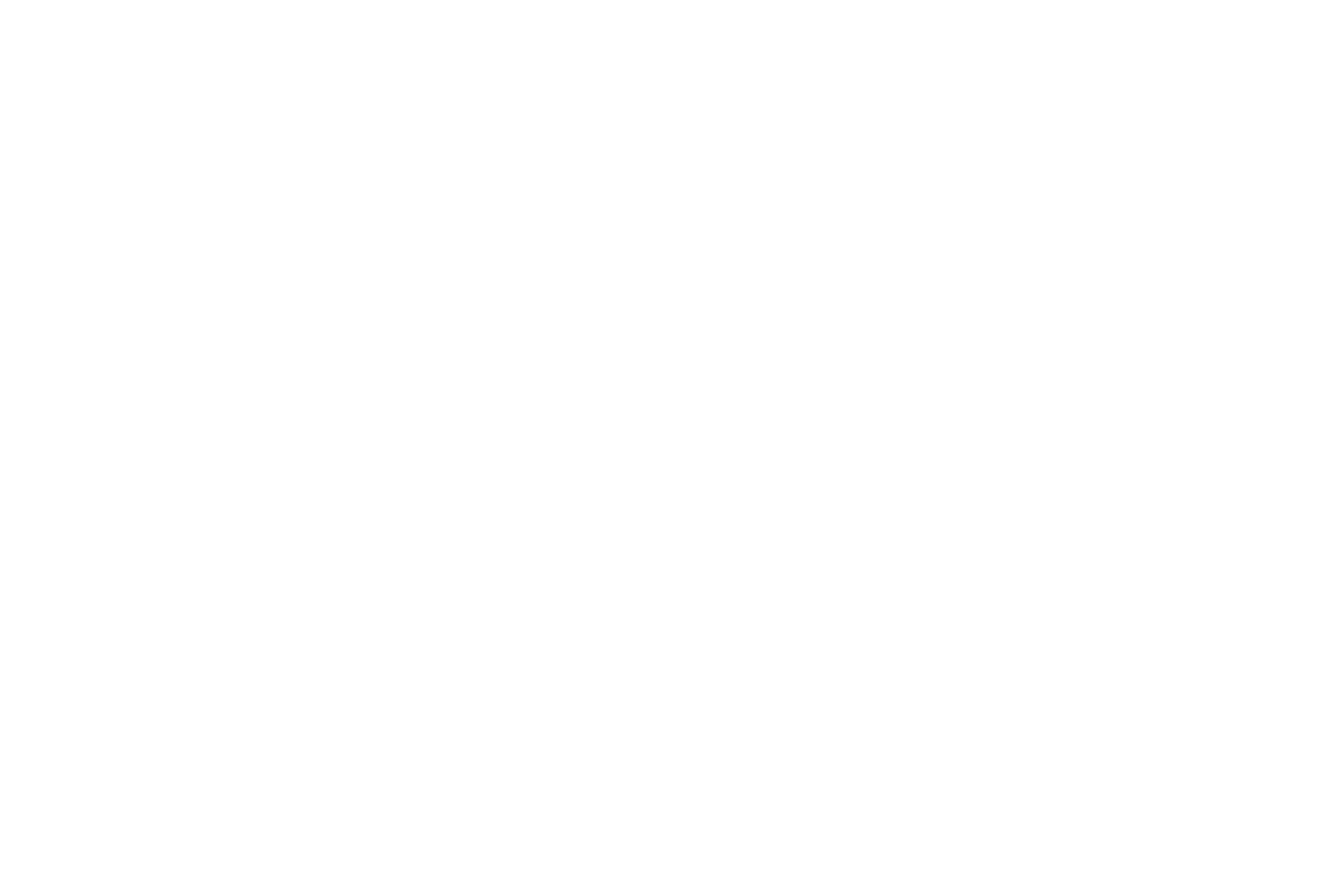Janvier 2022 - Enfin de retour à la Barbade, après 18 mois d’absence ! Depuis le 30 novembre 2021 l’île est une république. Je me promène dans Bridgetown. Un changement indéfinissable flotte dans l’air. Arrivée à la place de l!Indépendance, je promène mon regard sans que rien ne l!arrête: Tiens ! L’Amiral Nelson ne me toise plus du haut de son piédestal. Encore une « victime » de la cancel culture qui prétend effacer le passé pour le réparer ? Non, plutôt le fruit bien mûr d’une réflexion menée pendant des décennies et dont l’aboutissement fut de déplacer la statue dans le Musée national de la Barbade. Mais pourquoi ce héros de la Royal Navy qui a défait l'armée napoléonienne en 1805 gênait-il tant les Barbadéens ? C’est à Freedom Village, une commune rurale de la Barbade, que je l’ai compris.
De Freedom Village, le village de la liberté, il ne reste qu’une grande statue, toute simple, en pleine nature. Personnages frappants par leur maigreur. Un homme, une femme, un enfant, qui, pour la première fois dans l’histoire de la Barbade, ne craignent plus qu’on les sépare pour être vendus au plus offrant, comme le prônait l’Amiral Nelson.
En regardant cette statue, j’imagine le destin de ces individus, des héros à plus d’un titre, car ils ont survécu à toutes les étapes tragiques de la vie d’un esclave.
Volés à leurs familles dans leurs pays africains respectifs, cet homme et cette femme -appelons-les «Kofi » et «Abena »- sont embarqués au début du 19ème siècle sur des navires britanniques -comme trois millions d’Africains- pour le « Passage du milieu »* dans des conditions d’une barbarie sans pareil. A la Barbade, premier port de débarquement de la traite négrière, toute la « cargaison » est enfermée dans un cachot appelé « The Cage » à quelques pas de la place surplombée par l’Amiral Nelson, en attendant le jour de la vente des futurs esclaves. Plus tard, les colons anglais du quartier se plaindront tellement des cris et des odeurs nauséabondes qui se dégageaient de ce cachot que les autorités de l’époque décideront finalement de le déplacer vers un lieu moins résidentiel.
Après avoir été anéantis physiquement par la traversée de l’Atlantique, Kofi et Abena qui ne se connaissaient pas encore sont soumis par leurs nouveaux maîtres à l’anéantissement moral et psychologique, pour les réduire à l’état d'esclave en brisant leur âme. Car une fois dépouillés de leur humanité, il devenait normal de les traiter comme des objets, voire des bêtes. Leur nom, leur identité, leur sont arrachés. Ils sont rebaptisés « Paul » et « Leslie », avec comme patronyme celui du maître de la plantation, signe non pas de lien affectif mais de propriété.
Si les conditions de vie et de travail des esclaves dans les plantations des Caraïbes sont bien connues, ce qui l’est moins c’est que le système d’esclavage mis en place à la Barbade était le plus violent de la région. Un système fondé sur la tyrannie, la torture, les viols en série et l'exploitation organisée par les propriétaires de plantations.
Preuve en est : la moyenne de vie des esclaves était de 10 ans. C’est ce qui a poussé les autorités des puissances coloniales au bout de quelques décennies à réglementer le traitement des esclaves, non pas par humanité, mais pour des raisons économiques. A l’instar du Code noir édicté sous Louis XIV, les lois britanniques avaient pour objectif d’organiser les conditions de vie des esclaves pour assurer le maintien de l’ordre et surtout la productivité économique. Précepte de base : les esclaves étant un bien matériel constitutif du patrimoine du maître, il fallait en assurer la pérennité dans un souci de rendement économique.
Revenons à Paul et Leslie. Séparés dès le départ des autres membres de leur communauté, ils recherchent un peu d’humanité pour résister. Communiquer ? Chanter ? Danser ? Faire de la musique ? Interdit ! Cela pourrait favoriser les liens entre les esclaves et faciliter leur révolte. Mais l’instinct de survie étant le plus fort, ces êtres humains réduits en esclavage trouvent le moyen de contourner les interdits. Dans le champ de canne à sucre, dès que le surveillant a le dos tourné, Paul et Leslie réussissent à communiquer en accolant des mots de leurs langues respectives au rudiment d’anglais qu’ils ont appris. C'est la naissance des langues créoles qui essaimeront plus tard dans la région. Le soir, dans leurs cases, pour se défouler, les hommes tambourinent en sourdine sur tout ce qui leur tombe sous la main. Quant à Leslie et ses compagnes de travail, elles libèrent leur corps de la fatigue de la journée en se déhanchant discrètement au rythme des percussions. Arrive enfin la fin de la saison de la récolte du sucre, « Crop-Over **» seule période de l’année pendant laquelle les loisirs sont autorisés. J’imagine alors Paul se rapprocher de Leslie et épouser son mouvement de déhanchement pour danser avec elle corps à corps au rythme des percussions battues par leurs compagnons. Un hymne à la vie, à la reproduction, qui donnera naissance au « wukkup », la danse sensuelle qui ne laisse aucun spectateur indifférent pendant les carnavals des Caraïbes.
Se rebeller contre les maîtres ? Les ancêtres de Paul et Leslie avaient bien tenté de revendiquer leur droit à la liberté aux côtes de l’esclave Bussa en 1816, enhardis par le décret d’abolition de la traite négrière dans l’Empire britannique. Bien mal leur en prit : interdiction du commerce des esclaves africains ne voulant pas dire interdiction de l’esclavage, il ne fallut pas plus de trois jours aux soldats britanniques pour étouffer la révolution dans l’oeuf.
En 1833 c’est au tour de Leslie et Paul de nourrir de faux espoirs : sous la pression des mouvements abolitionnistes au Royaume-Uni - et surtout, avec le déclin du commerce du sucre - l’abolition de l’esclavage est enfin décrétée. Finie la servitude ? Pas encore. Car pour sauvegarder les intérêts économiques de la plantocratie, un système d’apprentissage est savamment mis en place. Sous prétexte de leur apprendre un métier (le leur !) qui leur permettra de jouir de leur liberté à venir, Paul et Leslie sont contraints de continuer à travailler dans la plantation de canne à sucre de leur maître sans rémunération.
Seul soulagement : devenus entretemps un couple, ils n’ont plus à trembler à l’idée que leur famille ne soit déchirée par la vente de l’un d’eux à un autre maître.
Ce n’est qu’en 1838 que l’esclavage est réellement aboli dans l’Empire Britannique et que « l’Emancipation » devient une réalité. Et qui, croyez-vous, la Couronne britannique a-t-elle jugé bon de compenser en déboursant la modique somme de 20 millions de livres sterling de l’époque (plusieurs milliards de livres en valeur actuelle) ? Les anciens esclaves ? Pas du tout ! Les « malheureux » propriétaires d’esclaves, privés de leur main d’oeuvre gratuite !
Même si l’Emancipation - que la Barbade fête le 1er août - est le début d’une ère nouvelle, la liberté n’apporte pas immédiatement la délivrance tant attendue. Suivent de nombreuses années de souffrances pendant lesquelles les anciens esclaves sont encore à la merci de leurs maîtres. Ils ont le choix entre travailler dans des conditions d’exploitation, mourir de faim ou partir. Mais partir signifie perdre son logement, recommencer à zéro au service d’un autre maître sans gage d’amélioration des conditions d’existence. Pour ne plus perdre tous leurs biens dans leur errance -voulue ou forcée- d’une plantation à l’autre, ces hommes et femmes à présent « libres » finissent par construire leurs propres maisons, transportables, les chattel houses qui font le charme de la Barbade d’aujourd’hui : des maisonnettes sans fondations, constituées de lattes de bois posées sur un muret de briques et qu’il suffisait de démonter pour les transporter ailleurs dans une charrette.
Après avoir subi le même mauvais traitement chez plusieurs maîtres, Paul et Leslie prennent une décision d’une hardiesse inouïe : ils décident de poser leur maison hors de toute plantation et de gagner leur vie en individus réellement libres. Plus facile à dire qu’à faire, puisque toute l’économie est aux mains des propriétaires de plantations. Ils connaîtront l’isolement, les défis que pose la liberté, surtout lorsqu’on n’y a pas été formé. Leur véritable récompense est de récupérer leur humanité, de pouvoir enfin vivre en vraie famille, avec leur fils, sans craindre d’être séparés ou vendus. Leur courage fera des émules, d’autres familles se joindront à eux et ensemble ils créeront le premier village libre, Freedom village à Rock Hall, dans la paroisse*** de Saint-Thomas.
Après ce voyage dans le temps face à la statue de Freedom Village, un frisson me traverse. Oui, les véritables héros de la Barbade sont «Paul» et «Leslie». Et Oui, conserver la statue de l’Amiral Nelson au Musée National de la Barbade après l’avoir déboulonnée est un devoir de mémoire qui permet aux descendants de Kofi et Abena de rappeler l’histoire tragique de leurs ancêtres.
Jihane Sfeir
22 avril 2022
* Le Passage du Milieu : La traversée de l’Atlantique par les Africains réduits en esclavage depuis l’Afrique vers les Amériques
** Crop-Over : Festivités marquant la fin de la récolte de la canne à sucre - Voir l'article
*** Paroisse : Unité administrative et territoriale de la Barbade qui en compte onze